1667 - Robert Hooke, astronome et mathématicien anglais (1635-1703), réalise un téléphone à ficelle.1854 - Charles Bourseul écrit un article dans l’Ilustration pour faire connaître ses idées sur le problème de la captation de la voix.1861 - Le professeur allemand Philip Reis réalise le premier appareil que l’on peut appeler microphone (en réalité, il transmettait plutôt des sons discontinus…).1876 - Après les travaux de Hermann von Helmholtz, on capte vraiment la voix que l’on transmet électriquement grâce à la modulation.La même année, Graham Bell dépose un brevet presque en même temps que l’américaine Elisa Gray dont le brevet est annulé. Le téléphone peut voir le jour.Nouveau : Le 11 juin 2002, la Chambre des Représentants du Congrès Américain a reconnu, après une série d'enquêtes et la découverte de documents, qu'un Italien, Antonio Meucci, ingénieur en mécanique émigré à Cuba puis ensuite aux États-Unis, avait fait à New-York en 1860 une démonstration publique de transmission de la parole à l'aide d'un fil de cuivre relié à deux électro-aimants à noyau avec diaphragme servant alternativement d'écouteur et de micro. Sur son cahier de laboratoire retrouvé, on voit plusieurs schémas datés du 27 septembre 1870 reproduisant le principe même du téléphone tel qu'il sera réalisé ultérieurement. Antonio Meucci, qui n'était pas riche et parlait mal l'anglais, n'a jamais demandé de brevet (dont le prix était de 250 dollars, somme très importante à l'époque). Il a simplement déposé un caveat (mémoire manuscrit décrivant l'invention et demandant sa protection jusqu'à son achèvement) enregistré le 28 décembre 1871, renouvelé en 1872 et 1873 mais qui fut abandonné les années suivantes. Le brevet déposé par Alexander Graham Bell en 1876 est donc postérieur à la découverte d'Antonio Meucci, ce qui a été admis à l'unanimité par la Chambre des Représentants du Congrès.
On pourra comparer cette "affaire" à celle de la paternité de l'invention du Phonographe dont la description avait été faite dans un pli cacheté (correspondant aujourd'hui à l'enveloppe Soleau) déposé à l'Académie des Sciences par Charles Cros le 18 avril 1877. Cette description avait été ensuite publiée dans la revue "La semaine du Clergé" par l'abbé Lenoir (sous le pseudonyme de Leblanc) le 10 octobre 1877. L'auteur de l'article utilisait pour la première fois le terme "Phonographe".
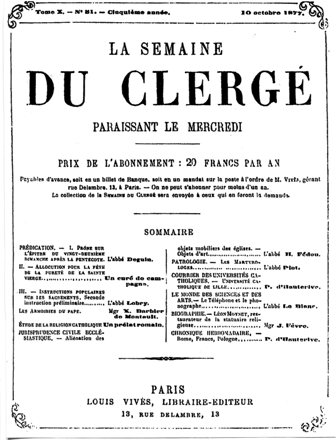
Numéro du 10 octobre 1877
Thomas Alva Edison ne fit fabriquer le premier appareil - qu'il baptisa lui-aussi "Phonograph" - que le 29 novembre de la même année par son mécanicien Kruesi (il fut terminé le 6 décembre). Le brevet - déposé en décembre 1877
aux États-Unis - n'a été accordé à Edison qu'en mars 1878 (voir ci-dessous).
L'auteur de ce site a écrit une pièce en deux actes sur ce sujet, déposée à la Société des Gens de Lettres de France et intitulée "Monsieur le Phonographe, parlez-vous français ?".
En 2006, le Président de la Bibliothèque nationale de France, Monsieur Jean-Noël Jeanneney, l'a placée dans
le département des Arts du Spectacle de la BnF.
Elle n'est pas encore éditée à ce jour.1877 - En avril, le poète français Charles Cros dépose un pli cacheté à l’Académie des Sciences. En octobre, la revue française La semaine du clergé publie dans la rubrique "Le Monde des Sciences et des Arts" la description de cette invention faite par l’abbé Lenoir sous le pseudonyme de Leblanc (voir ci-dessus).

Micros de téléphone
(Collection Marcel Cocset)Fin novembre, Thomas Alva Edison remet à son mécanicien Kruesi le croquis d’un appareil à cylindre rotatif sur lequel il a écrit "Kruesi, make this" avec la date Aug 12/77 (mais ce dessin a peut-être été anti-daté pour pouvoir obtenir la paternité de l'invention).1878 - Le brevet demandé par Edison en décembre 1877 est accordé en mars 1878. Le phonographe à feuille d’étain enroulée sur un cylindre entre dans l’histoire et Edison construit ensuite un microphone à charbon.1885 - La feuille d’étain utilisée à l’origine comme support d’enregistrement est remplacée par un cylindre de cire grâce à Chichester Bell et Charles Summer Tainter.
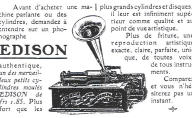
Publicité de l'époqueEntre 1880 et 1890, on perfectionne les microphones à charbon. Clément Ader utilise cinq crayons de charbon parallèles placés les uns à côté des autres pour augmenter la sensibilité. Puis les crayons sont remplacés par des grains de charbon.1887 – Berliner dépose un brevet concernant un disque plat, en verre et à gravure latérale, remplacé en 1988 par un disque en zinc, puis en 1889 par un disque en caoutchouc durci appelé vulcanite1898 - Le danois Valdemar Poulsen construit le Télégraphone
(appareil d’enregistrement magnétique sur fil d’acier).À partir de 1899, des disques de 17 cm, une face, sont édités par la Berliner Grammophon. Ils font concurrence aux cylindres de cire d’Edison qui se vendent bien.1900 – La Gramophon Company, qui portera plus tard le nom « La voix de son maître », achète les droits de reproduction du tableau de Francis Barraud représentant le chien Nipper assis devant le pavillon d’un gramophone. Les étiquettes des 78 t/mn de cette firme (et plus tard des microsillons) conserveront l’image du fox-terrier et contribueront au succès des disques à aiguille.

Le chien Nipper1920 - Eugène Reisz, qui travaille pour la firme allemande AEG (Allgemeine Elektrik Gesellschaft), fabrique des micros à charbon de très bonne qualité. Ils seront utilisés jusqu’à la guerre de 1939-1945.1923 - George Neumann s’associe d’abord à Eugen Reisz et fonde ensuite sa propre société qui deviendra célèbre dans le monde des studios et des ingénieurs du son.1924 - Eugen Beyer fonde son entreprise à Berlin avec, comme activité, la fabrication de haut-parleurs pour le cinéma. C’est en 1937 qu’il présente le célèbre casque DT 48, puis en 1939 le premier micro Beyer dynamique M 19.

Micro dynamique BeyerLa même année, Rieger expérimente un circuit à inductance-capacité pour les microphones électrostatiques dont le principe de la capsule à condensateur avait déjà été étudié par deux américains, Wente et Crandall, à partir de 1920.1925 - Jusqu'à cette date, les disques étaient gravés par un procédé mécanique à partir d'un grand pavillon. C'est en 1925 qu'un disque a été gravé pour la première fois de façon entièrement électrique, depuis le microphone jusqu'au graveur en passant par un amplificateur à lampes grâce à l'invention de la diode de Lee de Forest en 1907. C'est Alfred Cortot qui jouait des oeuvres de Chopin.
1928 - Fritz Pfleumer invente la bande magnétique en papier kraft de 6,35 mm de largeur recouvert d’une couche d’oxyde de fer (brevet allemand n° 500 900). La même année, Curt Stille met au point un enregistreur sur ruban d’acier de 3 mm de largeur, perfectionné par l’ingénieur Marconi.
1930 – Harry Olson, en Amérique, invente le micro à ruban qui ne verra son plein développement qu’après 1940 avec les modèles RCA, Mélodium (42 B) et Beyer (M160, M 260, etc…).1936 - Le premier appareil d’enregistrement sonore portant le nom Magnetophon est présenté par la firme allemande AEG/Telefunken (l’orchestre philharmonique de Londres, sous la direction de Sir Thomas Beecham, enregistre à Ludwigshafen la symphonie n° 39 de Mozart).1940 - Walter Weber et von Braunmühl mettent au point la polarisation par haute fréquence (principe déjà trouvé en 1927 pour les émissions hertziennes grâce à deux américains, Carlson et Carpenter).1945 - Rudolf Goericke (physicien) et Ernst Pless (ingénieur) s’associent, en Autriche, pour fonder la firme Photophon, puis Phonophot suite à des problèmes de similitude avec d’autres entreprises. Elle deviendra très vite AKG (Akustiche u.Kino-Geräte : équipement pour l’acoustique et le film).

Micro AKG D 19En 1945 également, le professeur Fritz Sennheiser crée en Allemagne le laboratoire deWennebostel pour fabriquer des capsules de microphones. Le premier modèle dynamique MD 2 sort des ateliers Sennheiser en 1947 et le MD 21, encore en service aujourd’hui, est présenté par la firme en 1954.
1948 - La firme L’oiseau lyre réalise et vend le premier disque microsillon 33 1/3 t/mn ("L’apothéose de Lully" de François Couperin).1952 - En Suisse, le jeune étudiant Stefan Kudelski construit le magnétophone autonome à moteur à ressort Nagra I (« on nagra » signifie en polonais : il enregistrera). Le Nagra II sort en 1953 et le Nagra II C, à circuit imprimé, en 1955.La même année, à Zurich, Willi Studer commercialise le magnétophone grand-public T 26 qui sera ensuite transformé en A 36 (1955) puis en B 36 (1956), C 36 (1958), D 36 (1960), E 36 (1961), F 36 (1962) et G 36 (de 1963 à 1966) pour en arriver en 1967 au célèbre A 77 à transistors.

En 2013, cette bande magnétique vient de fêter ses 55 ans... !
Le son délivré est toujours parfait ce qui étonne ceux qui l'écoutent
quand elle est lue sur un magnétophone de 1954 !
1957 - Présentation du Nagra III transistorisé, à moteur à régulation électronique (roue phonique).1958 - Les firmes Decca et Erato vendent les premiers microsillons stéréophoniques (des essais avaient commencé en 1953 en Amérique).1962 - G.M.Sessler, ingénieur diplômé de l’Université de Göttingen et attaché à la firme Bell Telephone Laboratory met au point les premiers micros à electrets (« électrets » en français). Le principe avait déjà été étudié en 1954 par les physiciens Schodder et Schroeder puis, en 1960, par les russes Gukkin et Kopanyev.1964 - Commercialisation de la Compact Cassette (CC) par la firme Philips (elle existe encore aujourd’hui).

Quel succès ! Mais les appareils de l'époque sont moins fiables.1968 - Présentation du NAGRA IV-S à transistors, stéréophonique double piste. Un adaptateur (réf. QGB) est prévu pour l'utilisation des grandes bobines de 26 cm. Sa renommée est immédiate et de nombreux disques seront gravés à partir d'enregistrements effectués avec le Nagra IV-S.1979 - Les firmes Philips, Sony et Hitachi présentent le Compact Disc (CD), marque déposée, qui remplacera petit à petit le disque microsillon (mais ce dernier semble connaître une nouvelle vie dans les années 2010/2012 chez les passionnés de Haute-Fidélité).
1983 - Le DAT (magnétophone numérique) est annoncé par la firme Sony (la commercialisation sera faite en 1987 mais il disparaîtra après l'an 2000).1992 - Sony présente le MiniDisc numérique (marque déposée) et Philips commercialise la cassette DCC (Digital CompactCassette), cette dernière devant prendre la suite de la Compact Cassette (CC) mais ce ne fut pas un succès commercial et elle disparaîtra rapidement comme le "MiniDisc".1995/96 - Apparition des premiers graveurs de CD-R vendus dans le grand-public suivis rapidement par les disques CD-RW réenregistrables. Nagra présente un magnétophone qui ressemble au Nagra IV mais plus petit et moins lourd, sans bande magnétique, sous le nom d'ARES-C (ARES étant le Dieu de la guerre dans la mythologie). La firme de Stefan Kudelski (ce dernier est décédé le 26 janvier 2013) veut ainsi lutter contre l'invasion des marchés européens par les produits japonais ! L'enregistrement s'effectue sur une carte magnétique PCMCIA amovible.

Graveur de CD-R Pioneer1998 - Déjà étudié depuis plusieurs années en Amérique, le premier microphone numérique est fabriqué et vendu par la firme Beyer. Il a été mis au point par Kai Konrath assisté du docteur Jahne de la Stage Tec Company.
La firme Neumann réalise également un microphone numérique sous la référence "Solution D" (présenté dans le catalogue 2002).1998/2010 - Le développement des ordinateurs avec cartes son, les mini-studios, les pupitres de mixage numériques, les graveurs de CD-RW et ensuite les appareils d'enregistrement à mémoire numérique intégrée ou sur carte enfichable, permettent aux amateurs et aux musiciens de réaliser eux-mêmes leurs prises de son avec une qualité équivalente à celle des studios d’il y a quelques années. Dès le début des années 2000, de nouveaux magnétophones numériques ont fait leur apparition comme le Nagra V et le Cantar (de la Société Aaton de Grenoble) avec enregistrement sur disque dur, ou le modèle anglais Edirol R-4 (voir la 6e édition du livre
" Les Magnétophones, enregistreurs numériques et analogiques "
de Claude Gendre, parue en août 2005 aux éditions Dunod et toujours en vente).©Texte et photos C.Gendre
18 novembre 2004/2 février 2006/31 mars 2013Page précédente < > Page suivante