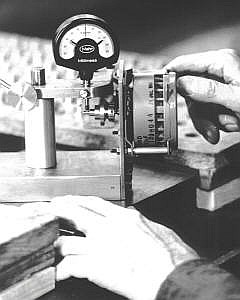Un
célèbre magnétophone :
le
Uher 4000 Report
******
C'est
au début des années soixante que la firme Uher de Munich
présenta
pour la première fois le magnétophone autonome
Uher
4000 Report, suivi assez rapidement par
plusieurs
autres
versions qui ont fait le bonheur des amateurs
d'enregistrement
sonore.
Jusque-là,
ces derniers étaient obligés de transporter un matériel
lourd
et encombrant, tributaire d'une alimentation en courant
électrique
110 ou 220 volts s'ils voulaient faire une prise de
son
de qualité (à cette époque, le 110 volts existait
encore
en
France, en particulier à Paris).
Certes,
le Nagra III était déjà en service mais son prix très
élevé
le
réservait aux professionnels ou aux gens fortunés.
Or,
on peut être à la fois passionné de prise de son tout
en ayant
un
revenu modeste. J'avoue avoir toujours rêvé d'acheter un Nagra
ce
qui ne m'est jamais arrivé... ! Certes, je m'en suis parfois servi
mais
c'est bien le Uher qui m'a donné la possibilité d'interviewer
Maurice
Herzog et Jean-Marie Marcel (photographe du Général
de
Gaulle), de faire des reportages au Maroc puis dans un
Boeing
747 entre Orly et New-York, sans oublier
une
plongée dans le Mésoscaphe au fond du lac Léman !
Les
exemples sonores que l'on trouve sur les
CD
inclus dans mes livres édités chez Eyrolles
sont
là pour le prouver.
Avec
une bande passante de 40 à 20 000 hertz à 19 cm/s,
un
pleurage inférieur à 0,2 % (0,15 % en pondéré)
et
une dynamique de 56 db, que pouvait-on
demander
de mieux il y a 40 ans ?
En
1963, j'ai été reçu par le Baron Von Horstein, Directeur
des
"Uher
Werke" dont l'usine se trouvait à Munich. Ayant acquis
le
premier modèle Uher 4000,
j'avais fait quelques critiques,
en
particulier au sujet de grésillements qui s'entendaient en fond
sonore
dans les enregistrements. Ils provenaient soit du moteur,
soit
de décharges d'électricité statique prenant naissance
aux
points
de frottement des courroies ou du volant lourd
faisant
tourner le disque solidaire du cabestan.

Dans un
atelier des Uher Werke de Munich, Claude Gendre est au
premier
plan (il tient son appareil photo dans les mains), face au
Baron Von
Horstein qui a son interprète à sa gauche.
(Photo
Uher Werke)
Il
m'expliqua qu'à l'origine, l'appareil avait presque été
considéré
comme un jouet et n'avait jamais eu la
prétention
de rivaliser avec un modèle "Haute-Fidélité".
Ce
sont les utilisateurs qui exigeaient de lui des performances
pour
lesquelles il n'avait pas été prévu. Ces exigences
amenèrent
d'ailleurs
la firme à améliorer le Uher
4000 dans les années qui
ont
suivi au point qu'il contribua beaucoup au développement
de
l'enregistrement d'amateur en France et dans le monde.
Quand
on écoute vingt-cinq ans après le document
"L'enregistrement
sonore, témoignage du passé" qui m'a
valu
un premier prix international au CIMES 77 à l'occasion de
l'anniversaire
de l'invention du phonographe (le jury était
réuni
à Wien en Autriche), on est surpris de sa qualité
sonore
étonnante alors que toutes les prises de son avaient été
faites
sur un Uher, le montage ayant été effectué sur un
Revox.
Dès
la fin des années cinquante, la firme Grundig avait elle-aussi
présenté
un petit magnétophone autonome sur piles, le "Niki".
Malheureusement,
il n'avait pas de cabestan et la bande était
entraînée
par la bobine réceptrice. C'était vraiment un gadget !
Pourtant,
à l'époque, le grand-public avait été enthousiasmé
par
la possibilité de pouvoir conserver le son comme on le
fait
pour l'image avec un appareil photographique !
Le
Uher
4000 était très supérieur
et ceux qui l'avaient
acheté
l'utilisaient au maximum de ses possibilités en raison
de
sa qualité qui dépassait ce que les ingénieurs avaient
espéré !
Le
baron Von Horstein me présenta donc un nouveau modèle,
sur
lequel les premiers défauts avaient été corrigés.
Il faut savoir aussi que dès la
mise au point du Uher 4000 Report
monophonique à 2 pistes,
la firme Uher avait prévu deux autres
appareils identiques, mais en stéréo
: le Uher 4002 Report stéréo
(à 2 pistes) et le
Uher 4004 Report stéréo (à
4 pistes).
En effet, le premier disque microsillon stéréophonique
ayant été
présenté en 1957 par la firme Erato, les
amateurs d'enregistrement
souhaitaient depuis cette date faire des prises de son
selon cette
technique. La firme Uher avait donc devancé le
NAGRA IV S
stéréo puisque celui-ci n'a été
commercialisé qu'en 1971.

Uher 4004
Report Stéréo de la première génération.
Les premiers
modèles
étaient caractérisés par un capot blanc-crème,
avec une petite
fenêtre
rectangulaire au centre pour pouvoir contrôler
le remplissage
des bobines.
(Photo
C. Gendre)
Après ces premières séries, le nouveau
Uher
4000 Report S
conserva le même capot blanc mais avec une face
avant modifiée
et un bandeau devant la grille du haut-parleur.
En revanche, le modèle suivant, en mono 2 pistes,
appelé
Uher 4000 Report L,
connut plusieurs transformations
: le capot fut peint de la même
couleur que le reste du coffret
et une grande fenêtre en matière
plastique transparente laissait
voir les bobines afin d'éviter de se
trouver en fin de bande sans que l'on s'en soit aperçu
pendant une prise de son.
À 19 cm/s, les bobines de 12 cm de diamètre
ne permettaient en effet
que 20 minutes par piste avec une bande longue durée,
30 mn avec
une double durée. Comme dans le cas de la première
série, la
firme Uher avait prévu deux autres modèles
en stéréophonie,
présentés dans le même coffret mais
avec naturellement
deux vu-mètres pour le contrôle du niveau
:
le Uher 4200 Report Stéréo
(à
2 pistes) et
le Uher
4400 Report Stéréo (à
4 pistes).

Modèle "Uher
4000 Report L"
successeur
des premiers appareils
de la série "Uher 4000".
Il a toujours les quatre vitesses que l'on
peut choisir par le
contacteur placé à droite, au
dessus de la prise DIN du micro.
(Document Uher
Werke)